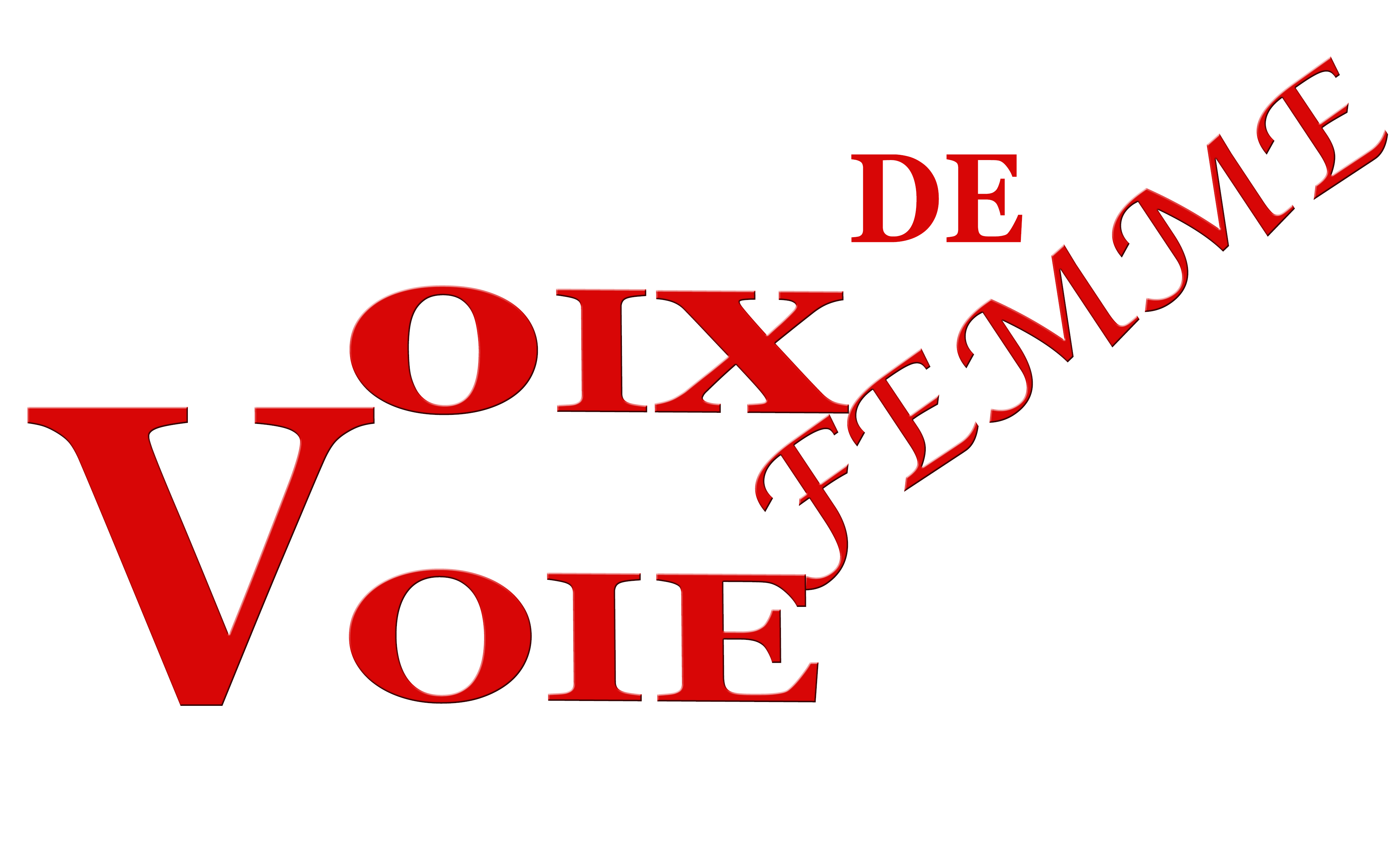Autrefois «un acte symbolique», la dot est devenue une contrainte et même un lourd fardeau.
Cadeau apporté à la famille de sa future épouse, pour exprimer l’intérêt de vouloir avoir comme femme leur fille, la dot a connu beaucoup de déviations. La dot ne date pas d’aujourd’hui. Il faut savoir qu’au Moyen Age le mariage n’était pas une affaire personnelle, fondée sur l’attirance entre deux individus et sur leur décision propre de mener une vie commune. C’était plutôt une affaire de groupe familial tout entier qui choisissait collectivement un conjoint pour l’un des siens. Faisant fi des penchants et sentiments des intéressés. La dot étant un des symboles de cette démarche. La dot se fait sous plusieurs formes. La dot par prestation de services, la dot en numéraire ou la dot en nature, la plus rependue.
La dot est donc l’apport de biens par une des familles, ou par le (la) fiancé(e), au patrimoine de l’autre, ou du nouveau ménage. Le paiement de la dot est vu comme un acte qui permet de rendre le mariage légal aux yeux de la communauté. Dans la tradition purement africaine, il est difficile de dissocier la dot du mariage traditionnel.

Institution tant exigée dans le processus de mariage traditionnel en Afrique, la dot se pratique en Côte d’Ivoire. Mais sur le plan législation, la dot a connu une histoire en Côte d’Ivoire. Cette pratique avait été interdite par la loi n° 64-381 du 7 Octobre 1964 du Code civil Ivoirien sur le mariage avant d’être autorisée par la loi n 2019-570 du 26 juillet 2019 relative au mariage.
Aujourd’hui c’est la question se rapportant à la dot qui fait l’objet de discussions. On se rappelle qu’en 2021, Nanan Kouassi Abadjinan, porte-canne du chef du canton Agni Bona Abradê, relevait déjà la déviation que prend aujourd’hui la cérémonie de la dot. « Aujourd’hui, nous constatons que la cérémonie de la dot est biaisée par les parents. Ils ne tiennent même plus compte de son fondement traditionnel et demandent aux soupirants des articles non reconnus par la tradition et des sommes faramineuses au lieu de six pièces de 10 francs symboliques exigées par la tradition », déclarait-il le 1er septembre 2021 lors d’une réunion à N’Dakro (Est, région du Gontougo). La tête couronnée n’est pas le seul à s’inquiéter. « C’est malheureusement ce qui est en train d’arriver. La dot est un élément de valorisation de notre culture. On vient voir comment on marie une femme chez tel ou tel peuple. J’insiste, il faut garder le volet traditionnel qui montre comment la dot se déroule chez les Bété, les Guéré, les Malinké, etc. Ce n’est pas à cette occasion qu’on va venir avec des robes blanches qui ne sont pas de notre patrimoine culturel », a fait remarquer Mme Odile Pohann (psychopédagogue).
On peut parler de dérive dans les cérémonies de dot d’aujourd’hui. Ce qui était une demande en mariage coutumier ou traditionnel, sans grande dépense, donne lieu, de nos jours, à de grandes fêtes avec des gâteaux, des dragées. Les cérémonies de dot coûtent cher. Elles n’ont plus rien de culturel, de familial.
Sékongo Naoua